
Saint Véran Pic de Château Renard.
2019
Utilisation du T500 extérieur
CTA102 quasar à 10 milliards d'années lumières
Mkr355
PGC7720
NGC1275 et amas de Persée
NGC 925
2020
Très mauvais temps toute la semaine! Un seul créneau de 2 heures environ ou on a réussi à imager Mars au T62
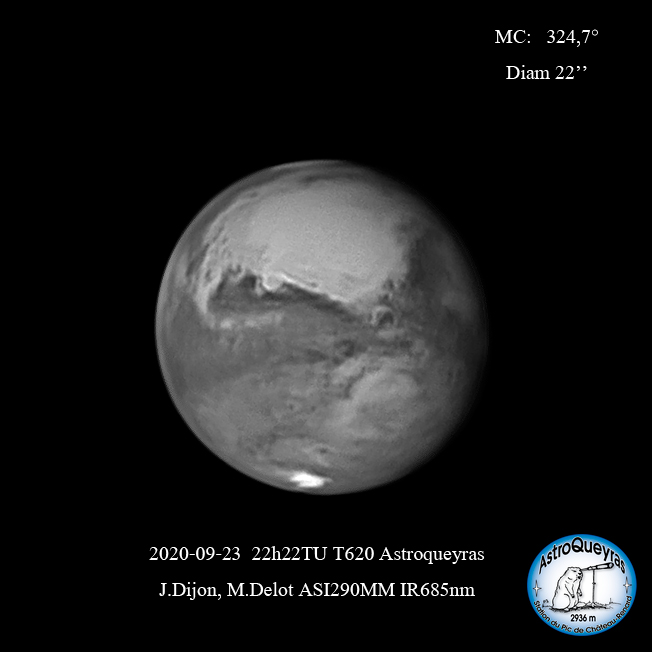
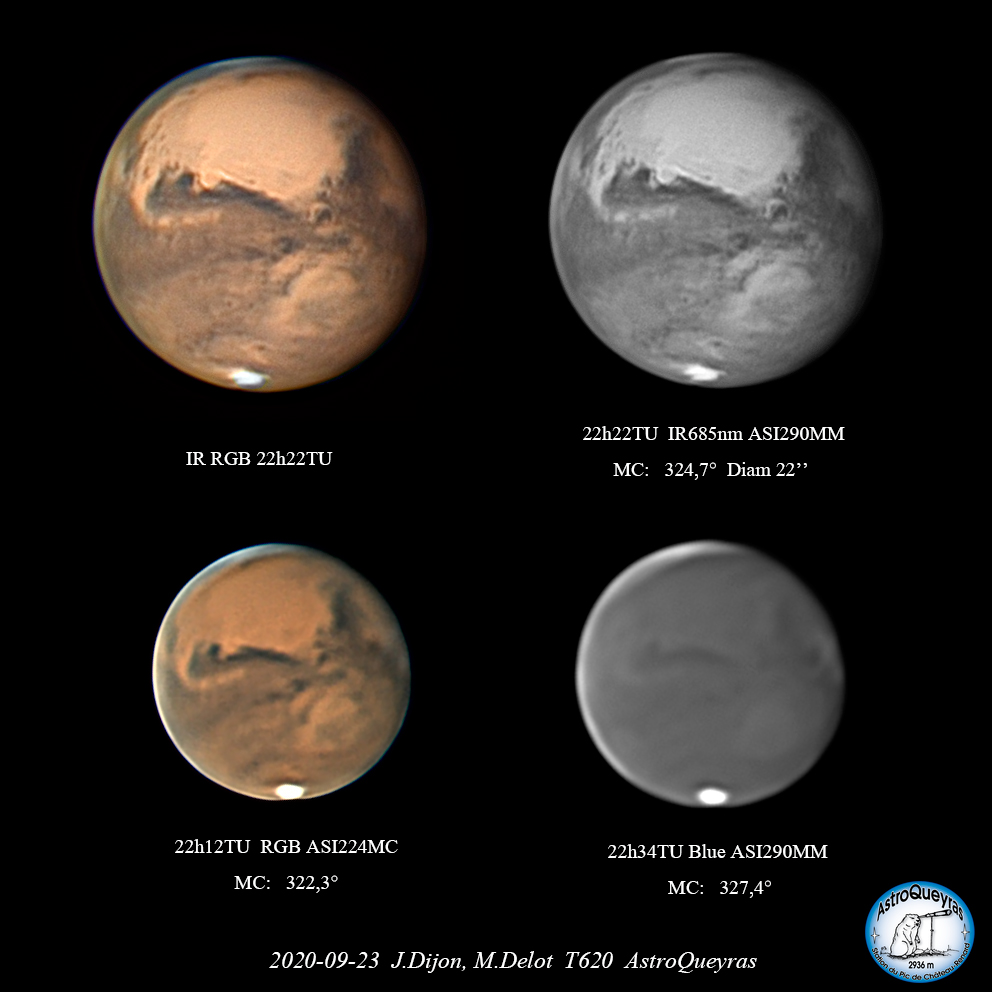
2021
Utilisation du T62
Détection de Charon charger l'article ici
Lune en plein jour
2022
Utilisation du T62 avec tentative de rapatrier les images dans la salle de contrôle avec un câble USB alimenté . Cela fonctionne par contre la mise au point ne peut pas être déportée. On a remarqué que la porte de la coupole doit être impérativement fermée pour améliorer le seeing, effet très net.
Les images ont été prises directement au foyer Cassegrain F=9.2m du télescope avec un ADC (correcteur de dispersion atmosphérique)
18 septembre
T62 images très mauvaises une seule image très moyenne a pu être obtenue

19 septembre
T50 pour spectre de IO de Jupiter et des divers satellites, objectif détection du sodium autour de Io
T62 images bien meilleures que la veille
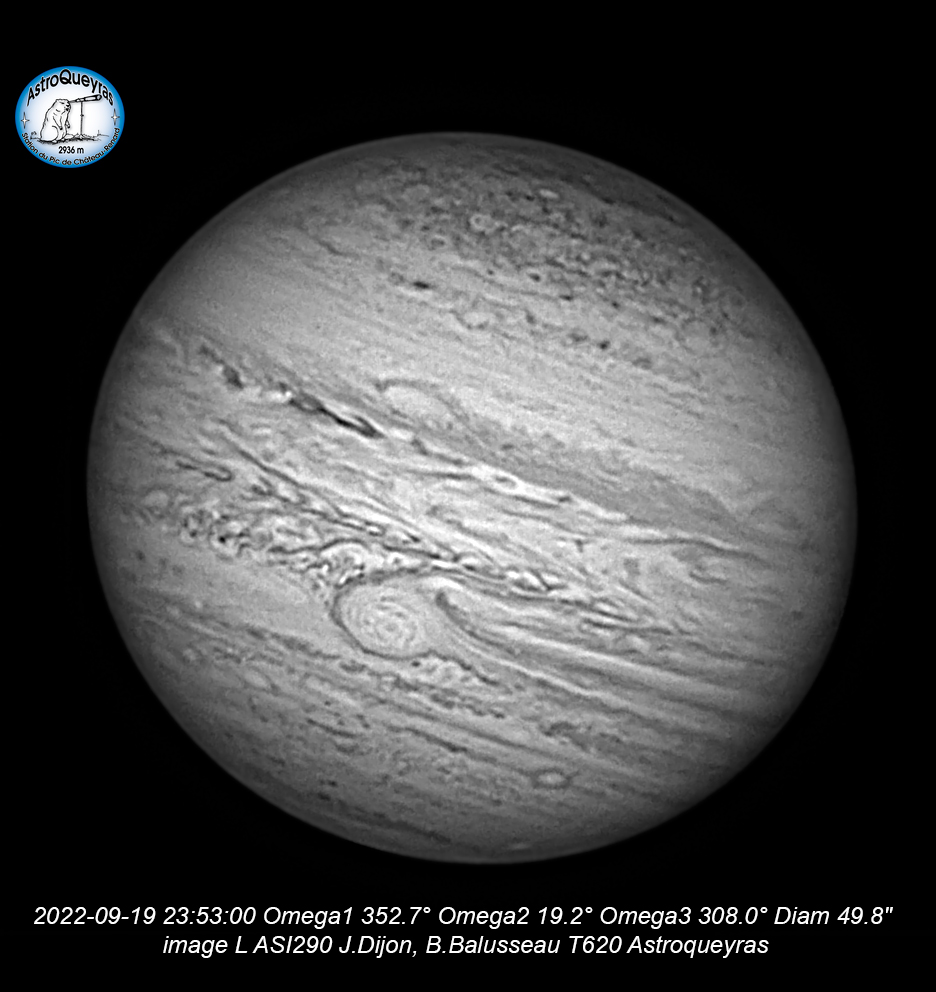
20 Septembre
ganymède
les images "Simulation" sont obtenues à partir de l'image de la surface à l'heure de l'observation obtenue dans le logiciel guide9 ces images ont leur résolution diminuée avec un filtrage gaussien et sont passée en noir et blanc pour être plus directement comparable aux observations.


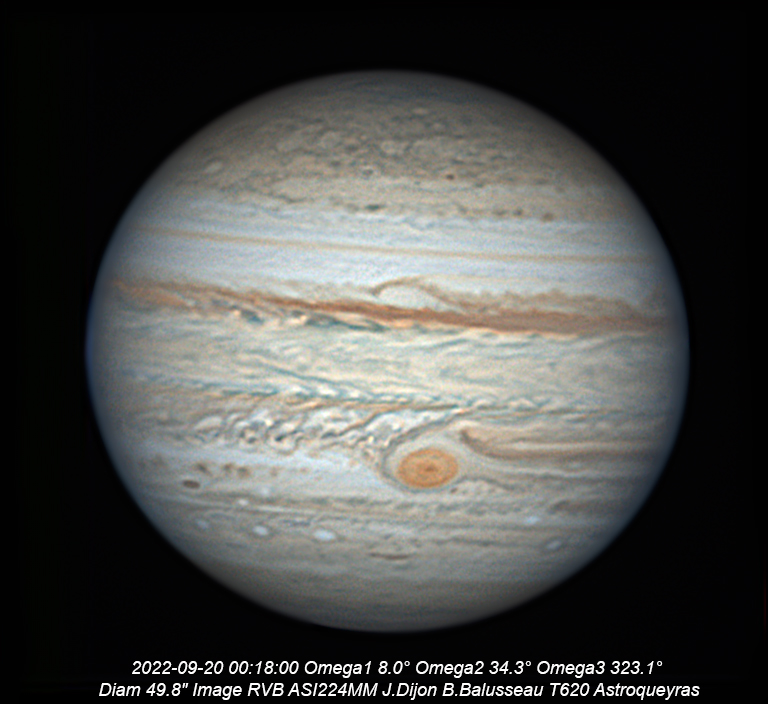
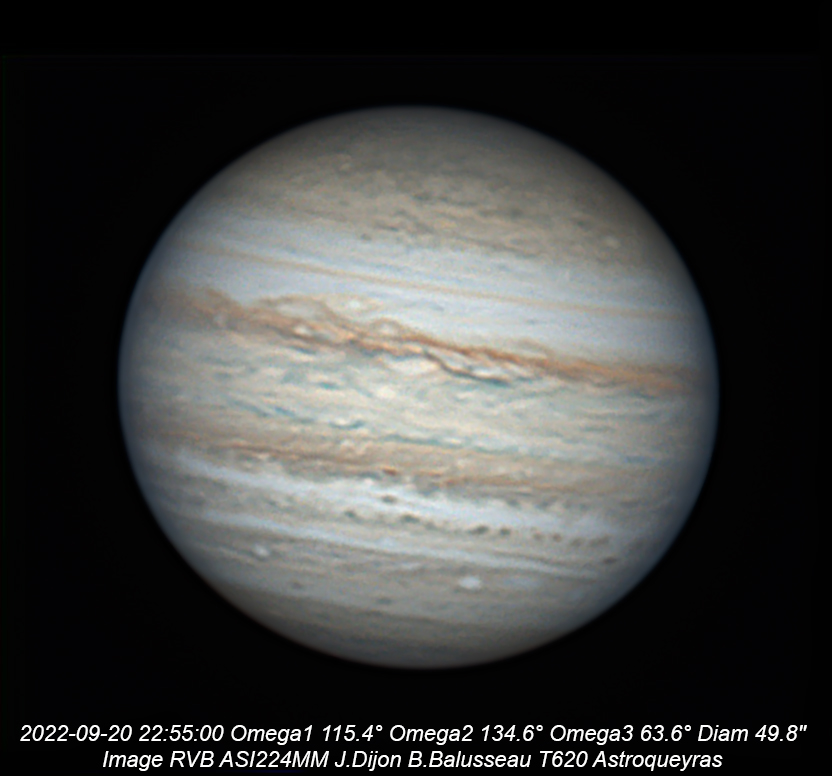
22 septembre
très bon seeing
un peu de turbulence mais beaucoup plus grande stabilité de l'image
Sur Saturne la division de Encke n'est pas loin
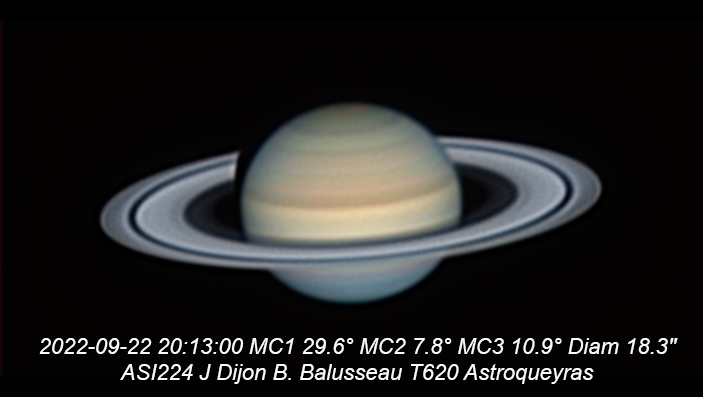
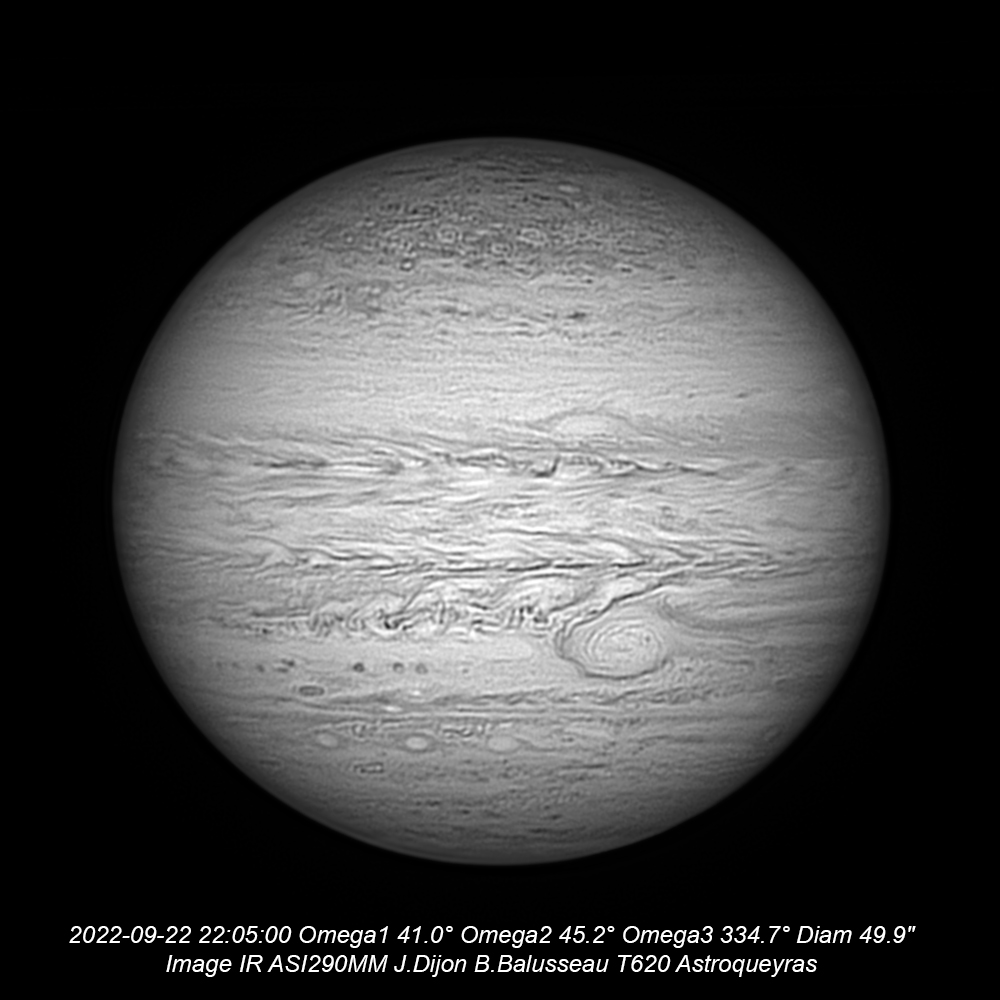
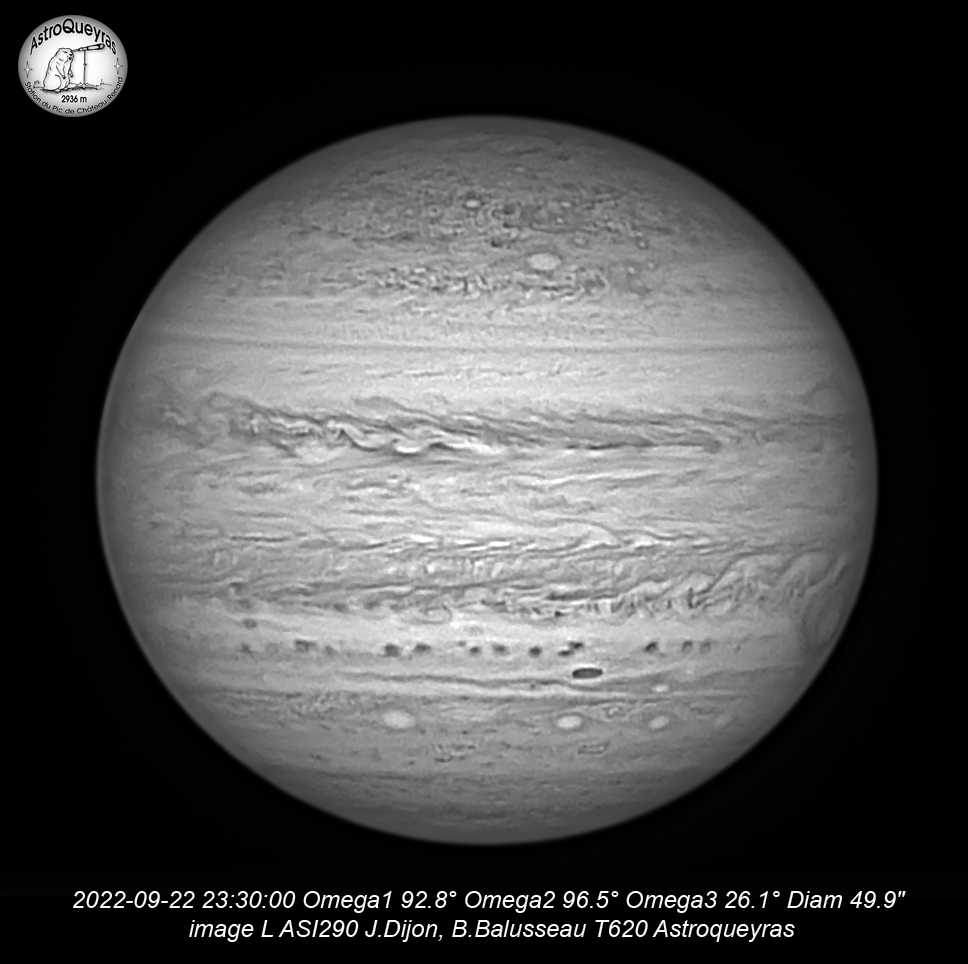
23 septembre

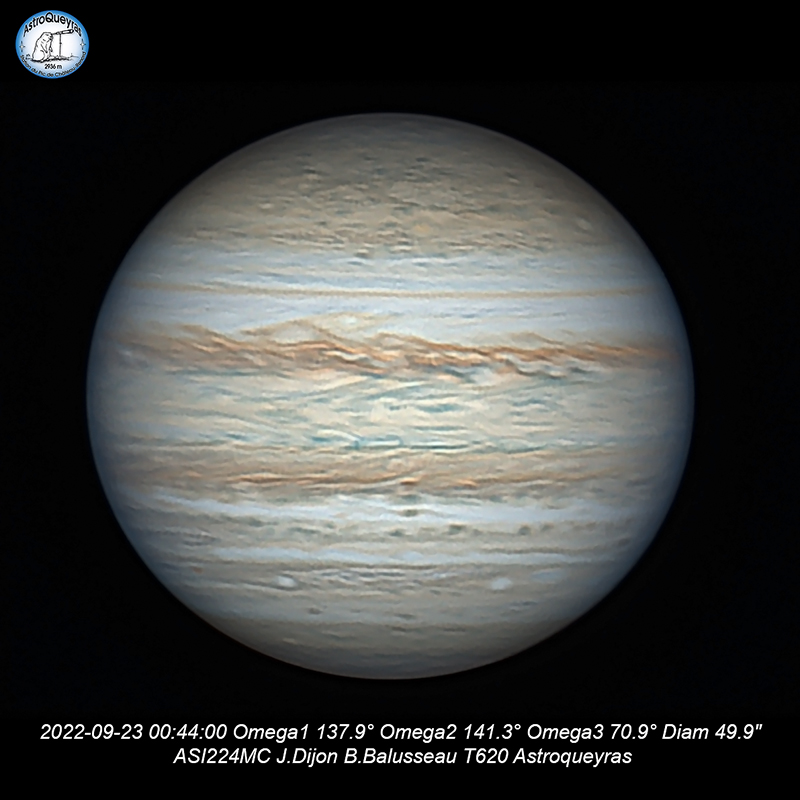
Ganymède

Mars
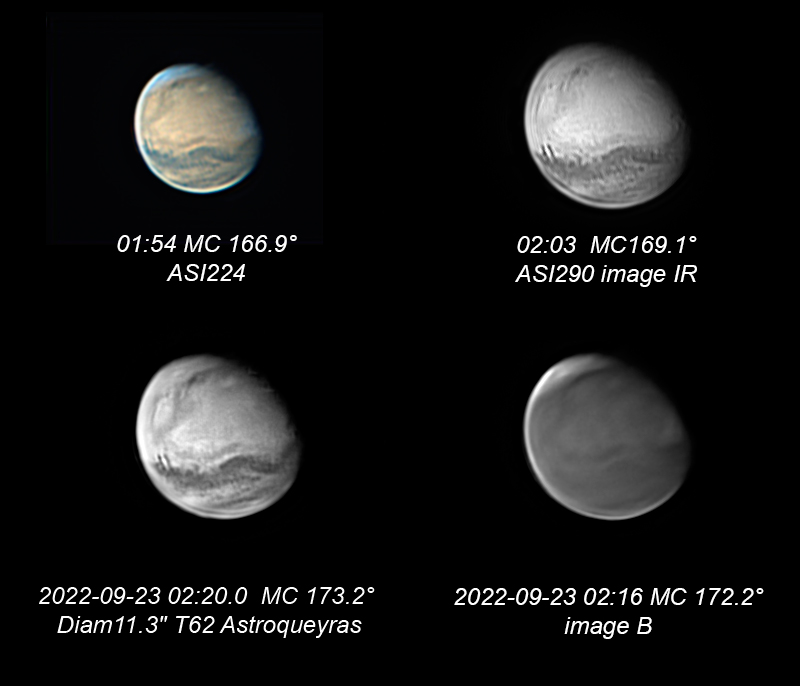
Article sur l'observation de Ganymède ICI
2023
Article sur l'observation de Jupiter ICI
2024
1) Observation d’Uranus
Nous avons tenté d’observer les anneaux d’Uranus en utilisant un coronographe
pour masquer la planète. Ce coronographe est installé sur un dispositif
comportant une lame dichroïque à 45° réfléchissant l’infrarouge au-delà de 650
nm et laissant passer le visible pour permettre le guidage du télescope sur la
planète. Ce dispositif (Figure 1), dont la pastille occultrice mesurant 100µm
est installée directement au foyer du T 500 de 4 100 mm de focale.


Figure 1 : À gauche, le dispositif réalisé, installé au foyer du télescope avec
les caméras utilisées : ASI290 pour le guidage dans l’axe, Player one mars MII
pour l’acquisition des anneaux à 90°. À droite le dispositif testé sur Saturne :
image de gauche IR avec la pastille occultrice, et image de droite dans le
visible.
L’observation des anneaux est beaucoup plus
difficile qu’escomptée. Nous avons résolu le problème de guidage du télescope en
utilisant PHD2 qui a permis de guider directement sur la planète Uranus. Malgré
cela, le 5 octobre, lors de l’observation, la turbulence était assez forte et le
guidage n’a pas pu maintenir en permanence Uranus derrière la pastille. Nous
avons réalisé 20 films de 4 à 5 minutes composés de poses unitaires de 0,5 s.
L’image résultant de l’empilement de 288 poses élémentaires est présentée en
figure 2. Les images du film où Uranus déborde de la pastille ont été supprimées
de cet empilement. Après dé convolution on observe bien les 5 satellites majeurs
d’Uranus ainsi qu’une étoile double du champ. On remarque également en bordure
de champ le reflet d’Uranus sur la face arrière de la lame dichroïque (réflexion
autour de 2% due à l’antireflet MgF2)
En empilant l’ensemble des images sur 16 bits et en soustrayant à cette image
l’image de référence (obtenue en empilant les images du film de 0h53), on voit
apparaitre l’anneau à la position attendue (figure 4). Sur cette image (figure 5
?) on a bien, au moins partiellement, l’image de l’anneau dans la direction de
son grand axe.

Figure 2 : Image du champ autour d’Uranus le 05 octobre à 0h53 TU, somme de 288
images posées 0,5 s. L’image a été déconvoluée avec blurX. Les zones brillantes
en bordure de la pastille correspondent à des zones où Uranus n’était pas
parfaitement centrée sous la pastille.

Figure 3 : Coupe de la somme des images (pose 1
h 18 ) et de l’image de référence.

Figure 4 : Coupe de l’image (somme-référence) de la figure 3, on observe bien
une structure correspondant à la position des anneaux (indiquée en haut de la
figure).
Figure 5 : Différence entre, à gauche, l’image
superposée avec la simulation d’Uranus, et, à droite, l’image de la différence.
L’anneau est bien visible dans la zone qui fait un angle d’environ 20° avec la
normale (flèche), la zone plus brillante (flèche courte) est probablement due
aux problèmes de guidage.
Conclusions
1) Malgré une météo assez défavorable et une seule tentative, nous avons
certainement détecté l’anneau d’Uranus. Les images ne sont pas satisfaisantes à
100 %, en partie à cause d’une turbulence relativement forte ainsi que de
l’absence d’une image de référence de la planète seule. Les problèmes de guidage
non complètement résolus ont également contribués à la diffusion autour de la
pastille. Nous n’avons pas utilisé de filtres IR supplémentaires pour affaiblir
encore la planète, un filtre à 742 nm ou même 800 nm aurait certainement
amélioré la détection. Nous avons également été pénalisés par la configuration
des anneaux pratiquement circulaires autour de la planète qui n’aide pas à les
extraire de la diffusion parasite de la planète. Pour l’instant nous n’avons pas
clairement démontré le gain d’un coronographe par rapport à la solution « lucky
imaging ».
2) Autres observations
Jupiter

L’image de Jupiter obtenue le 5 octobre montre bien que la turbulence était
relativement forte.
Mars

La Calotte polaire est bien visible, la planète
ressemble à ce qui a été vu durant l’opposition de 2022.